
Caroline, en tant qu'architecte d'événements sportifs, comment voyez-vous l'évolution de l'architecture des stades temporaires en termes de durabilité et de fonctionnalité?
Le terme stades temporaires, ou overlay comme nous l’appelons dans le secteur, a gagné en notoriété ces dernières années, notamment en réponse à la recherche croissante de solutions durables. Depuis les Jeux olympiques d’Athènes en 2004, une nouvelle voie s’est ouverte face aux difficultés rencontrées par les infrastructures permanentes, souvent sous-utilisées après les événements et laissées à l’abandon.
Bien que ces structures soient, par nature, moins durables que les stades construits de manière pérenne, leur flexibilité et leur faible impact environnemental en font des alternatives de plus en plus viables. Un exemple marquant de cette évolution est la création du tout premier stade entièrement temporaire pour la Coupe du Monde T20 de cricket — une véritable prouesse en matière de conception événementielle.
À mes yeux, cette approche représente une réponse concrète à la problématique des éléphants blancs. Lorsqu’ils sont bien pensés et intégrés dans une stratégie globale, les stades temporaires peuvent offrir une multitude de solutions innovantes et responsables, adaptées aux besoins actuels de durabilité et d’optimisation des ressources.
Pouvez-vous nous parler des défis spécifiques que vous avez rencontrés lors de la conception de stades temporaires pour les Jeux Olympiques, en particulier à Paris 2024?
Ce qui distingue particulièrement les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c’est l’implantation de structures temporaires au cœur de l’un des sites les plus emblématiques et les plus visités au monde, avec un héritage historique exceptionnel.
Ce contexte unique a posé de nombreux défis, notamment l’intégration d’installations architecturales éphémères dans un environnement patrimonial fort, dont l’identité visuelle se démarque naturellement. Il nous a fallu accorder une attention minutieuse à l’harmonie visuelle de l’ensemble afin d’assurer une insertion respectueuse et cohérente. Cette démarche a également impliqué l’optimisation des rares espaces disponibles dans la ville, tels que les places publiques, devenues de véritables terrains d’innovation.
Les contraintes physiques et écologiques, combinées aux exigences d’une intégration urbaine réussie, ont rendu cette mission à la fois exigeante et singulière. Ce fut un travail aussi stimulant que gratifiant.
Comment votre expérience lors des événements sportifs mondiaux précédents, comme Rio 2016 et Tokyo 2020, influence-t-elle votre approche actuelle de la conception de stades?
Effectivement, chaque pays présente ses propres spécificités, tant en termes de réglementation que de normes techniques. Par exemple, les Jeux Olympiques organisés au Japon m'ont offert l’opportunité d’explorer des solutions liées à la gestion des risques sismiques — des approches particulièrement pertinentes pour d'autres régions confrontées aux mêmes réalités.
La culture locale joue également un rôle fondamental dans la conception : elle influence non seulement les priorités mises en avant, mais aussi les technologies disponibles et les choix esthétiques. Ce qui me fascine dans l’univers des structures temporaires, c’est justement cette liberté. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ni la modularité ni la temporalité ne limitent notre créativité. Chaque projet, même s’il répond à des contraintes précises, ouvre de nouvelles perspectives, selon le contexte géographique et les publics auxquels il s’adresse.
Quels sont, selon vous, les éléments clés à considérer pour que les architectures temporaires puissent répondre aux exigences des événements sportifs tout en minimisant l'impact environnemental?
L’un des éléments clés reste, sans aucun doute, l’attention portée à l’économie et au tissu local. Dans le contexte actuel, il existe de nombreuses solutions issues des ressources locales, même temporaires, qui méritent d’être explorées et valorisées. Il est essentiel de les identifier, de les adapter intelligemment aux exigences spécifiques de chaque événement sportif, et de les intégrer dans une démarche cohérente et durable.
Pourriez-vous nous expliquer comment vous intégrez les nouvelles technologies et les innovations architecturales dans la conception de structures temporaires?
Comme toute technologie, les solutions temporaires évoluent en permanence, en fonction des nouvelles tendances et des innovations techniques. On peut citer, par exemple, l’intégration de panneaux de verre dans les structures de type tente, les conteneurs pliables, ou encore les toiles et membranes techniques capables de réduire l’impact thermique.
Rester à l’écoute des propositions des fournisseurs, qu’ils soient locaux ou internationaux, est essentiel pour enrichir la conception et intégrer des réponses adaptées et efficaces. Même l’évolution des logiciels de conception et de simulation joue aujourd’hui un rôle déterminant dans cette dynamique d’innovation.
Quelles influences culturelles ou personnelles trouvent-elles leur chemin dans votre travail et comment ces inspirations se traduisent-elles dans vos projets?
Je dirais que l’influence la plus directe que je peux avoir, c’est celle exercée par le public, les spectateurs eux-mêmes. Ayant eu la chance de travailler dans de nombreux pays, au contact de cultures très diverses, j’ai pu constater à quel point les habitudes et les attentes du public influencent profondément la conception des espaces.
Prenons l’exemple d’une zone de restauration : selon le type de public auquel elle s’adresse, l’approche spatiale peut varier considérablement — espaces plus fermés pour certains contextes culturels, plus ouverts et perméables pour d’autres. Ces variations conditionnent non seulement l’expérience du spectateur, mais aussi les solutions techniques et architecturales que nous pouvons envisager et mettre en œuvre.
En réfléchissant à l'avenir, quelles tendances ou innovations pensez-vous voir émerger dans le domaine de la conception de stades pour les grands événements sportifs?
La tendance la plus forte que j’observe — et que j’espère voir s’amplifier — concerne la réduction progressive de la construction de stades permanents spécifiquement dédiés aux événements sportifs. Par nature, ces événements sont temporaires, et leur caractère éphémère remet en question la pertinence de bâtir des infrastructures durables qui risquent de devenir sous-utilisées par la suite.
Par ailleurs, l’évolution technologique des matériaux disponibles aujourd’hui permet de répondre de manière de plus en plus efficace aux enjeux de durabilité et d’impact environnemental. On assiste également à une dynamique intéressante autour de la transformation et de la réutilisation de stades existants, qui peuvent être adaptés à de nouveaux usages ou configurations, prolongeant ainsi leur cycle de vie tout en limitant l’empreinte écologique.
Pour plus d'informations : https://wooarchitects.com/


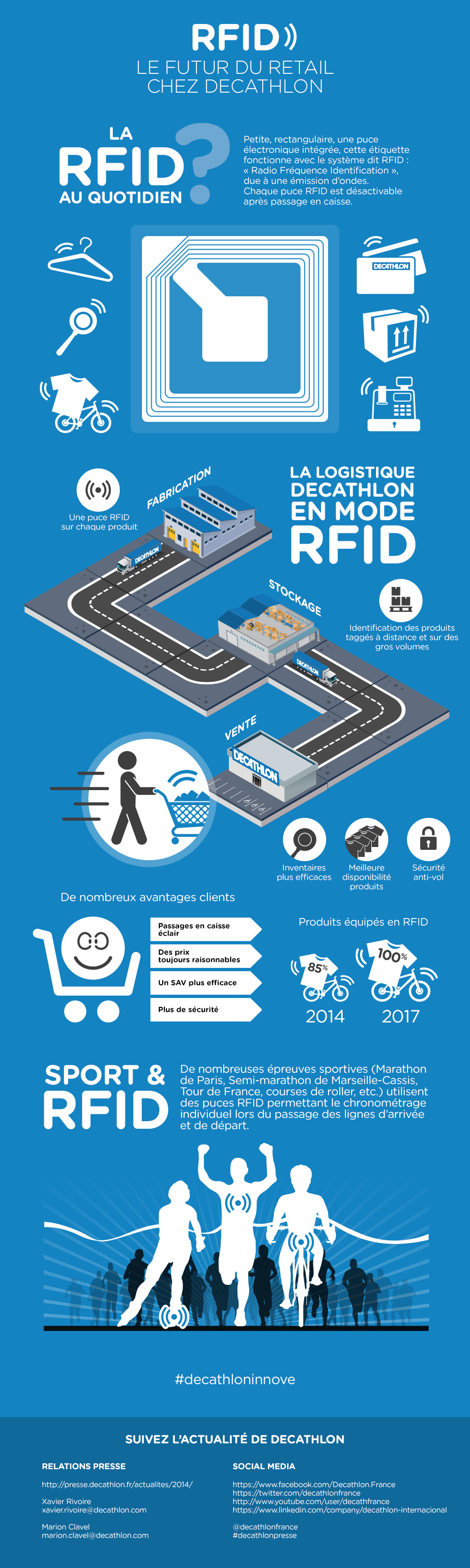








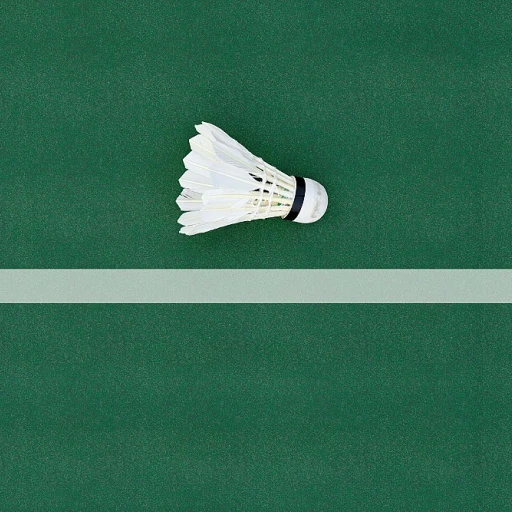
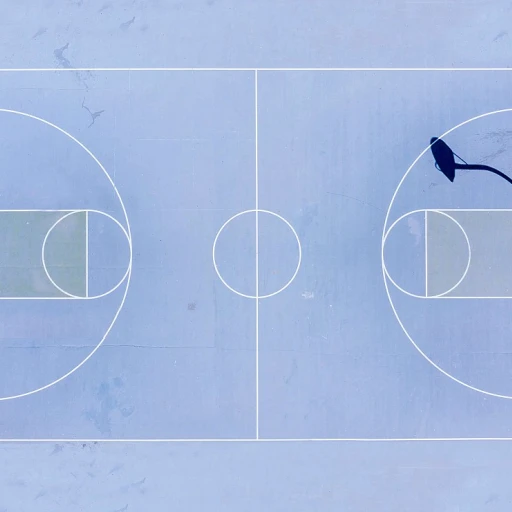
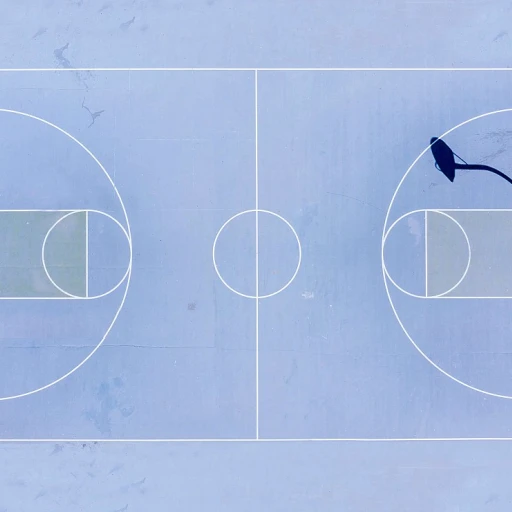
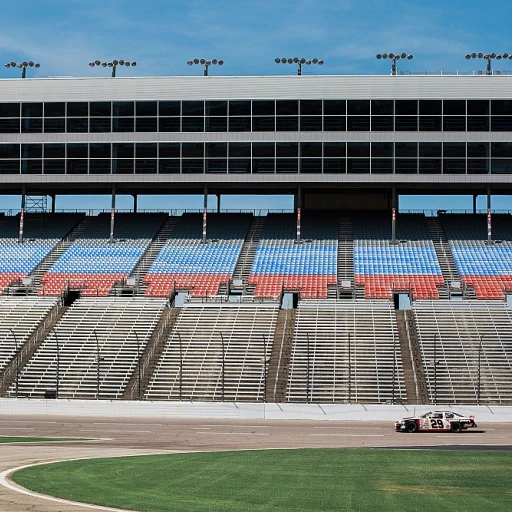



_resultat-large-teaser.webp)